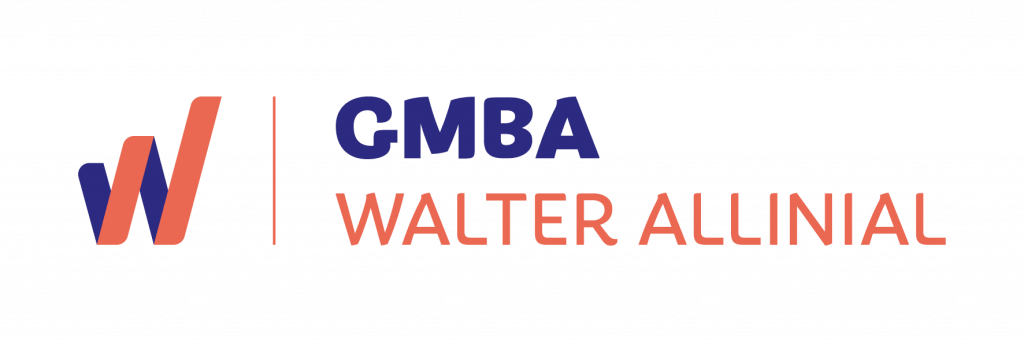Travail hybride : enjeux et opportunités pour les associations
Points de vue d’expert | 8 juillet 2022
Enjeux et opportunités pour le secteur associatif
Depuis les déconfinements progressifs se pose la question des modalités de pérennisation des dispositifs de travail à distance naissants ou d’amélioration de ceux qui préexistaient[1]. Réflexions autour des enjeux et des opportunités pour les associations de ces nouvelles façons de travailler.
Avec plus de 5 millions de Français en télétravail[2], la crise sanitaire a permis une expérience inédite à grande échelle : observer s’il était possible de travailler essentiellement à distance sur un temps long. L’expérience s’est révélée concluante : 71 % des managers et employés souhaitent désormais avoir la possibilité de télétravailler[3]. Au-delà du télétravail, la pandémie a favorisé l’essor de nouveaux modes de collaboration (visioconférences, missions à distance, team building virtuels, etc.). L’organisation du travail se transforme et devient hybride. Les sociétés ne sont pas les seules concernées, le secteur associatif l’est aussi. En témoignent certaines associations qui n’ont plus aucun bureau fixe. Chacun des membres collabore à distance, parfois éloigné de plusieurs centaines de kilomètres. En tenant compte de leurs spécificités, comme le mélange salariat/bénévolat ou encore la présence de valeurs fortes, le défi pour les structures associatives est de relever les enjeux de ces mouvements pour s’adapter et les transformer en opportunités.
Mettre en place le travail à distance de façon pérenne
Instauration du cadre légal
Selon le protocole sanitaire en entreprise, depuis le 2 février 2022, le télétravail n’est plus une obligation : y recourir est une décision propre à chaque employeur. Dans de nombreuses organisations se tiennent des débats sur le rythme de télétravail, oscillant du 100 % au zéro télétravail. La solution qui semble se profiler est celle de la pondération : à la fois du présentiel et du distanciel. Autrement dit, une pérennisation du travail hybride se dessine. Pérennisation qui implique l’instauration d’un cadre de fonctionnement.
La législation est un point de départ. Le télétravail est défini juridiquement par le code du travail[4]. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 et celui du 26 novembre 2020 le complètent en la matière. Il est à noter que, dans certains secteurs d’activité comme les télécommunications, des accords de branche ont pu être instaurés. Il convient alors de s’y référer. Ces textes indiquent que le travail à distance peut être établi par la signature d’un accord collectif ou à travers une charte élaborée unilatéralement par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE) s’il existe. À défaut, il est aussi possible de s’accorder avec le salarié en le formalisant par tout moyen.
Cette étape réglementaire permet de poser un cadre de base. Autrement dit, elle est l’occasion pour les dirigeants (bureaux, conseils d’administration, etc.) de mener une réflexion et de la formaliser. Elle répond aux enjeux importants qui sont de concilier des attentes très diverses et d’œuvrer à l’équité de traitement des équipes impliquées. Elle aboutit à un socle de règles communes qui définissent les principes généraux : modalités d’accès et vision du dispositif. Les équipes bénéficient de règles claires à partir desquelles se projeter. Mais le succès de la mise en place d’une organisation hybride peut nécessiter d’aller plus loin que ce seul cadre législatif.
Implication opérationnelle des équipes
Maxime Robache, auteur de l’ouvrage ‘Mettre en place et manager le télétravail’[5], voit l’accord ou la charte de télétravail comme une première étape dans l’instauration du travail à distance. Il propose de la prolonger par une implication des équipes dans la réflexion du projet collectif. Ces dernières peuvent contribuer à construire les réponses aux contraintes opérationnelles : quelles sont les règles pour réussir à télétravailler ensemble ? Quels jours de présence communs doivent être adoptés ? Comment organiser les plannings ? L’objectif est de décliner les principes généraux sous la forme d’un canevas opérationnel.
Ce processus est d’autant plus nécessaire dans les associations que les équipes sont souvent composées de salariés et de bénévoles dont les tâches et/ou les prérogatives peuvent se superposer. Leurs intérêts ne sont pas identiques, voire parfois contradictoires. La militance active du bénévole peut déborder du cadre de travail (horaires, comportements), alors que le salarié peut se montrer plus enclin à rechercher l’efficacité des actions de façon professionnelle. La mise en place du travail hybride ne doit pas augmenter les risques de frustration entre ces deux types de population : bénévoles libres de réaliser leurs engagements où et quand ils le souhaitent, salariés contraints à être présents, par exemple. Une implication de l’ensemble des équipes dans la mise en place de l’organisation permettra d’anticiper ces sources de conflit.
Processus expérimental et d’amélioration continue
Une fois qu’ils sont établis, l’erreur serait de figer les cadres généraux et opérationnels. Au contraire, le succès de leur mise en œuvre dépend de la capacité des associations à les rendre dynamiques. Ils doivent faire l’objet de processus d’amélioration continue avec des tentatives et des retours d’expérience. Les associations, souvent plus agiles et novatrices que les sociétés, ont tout intérêt à expérimenter.
Gérer les aspects pragmatiques du télétravail
La question des frais professionnels
Les organisations ne doivent pas négliger certains aspects pratiques. L’environnement du travail à domicile et les frais professionnels sont notamment des sujets importants. Il est indispensable que le salarié en télétravail dispose du matériel nécessaire (ordinateur, imprimante, connexion Internet, etc.). Se pose notamment la question de son financement. Le principe est que les frais exposés pour les besoins d’une activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier. Cette règle s’applique aussi en matière de télétravail. Deux méthodes de remboursement sont possibles : sur la base des frais réels à partir des justificatifs, comme une note de frais, ou sur la base d’une allocation forfaitaire. Les employeurs bénéficient alors d’une franchise de cotisations dans la limite globale de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine, soit jusqu’à 50 euros par mois pour cinq jours de télétravail par semaine.
L’importance de la sécurité
La sécurité et la santé des télétravailleurs ne doivent pas non plus être omises. Comme pour n’importe quel salarié, l’employeur doit s’en assurer. Cela implique de vérifier la sécurité du lieu, par exemple la viabilité des installations électriques. Une attestation sur l’honneur par laquelle le télétravailleur assure que son environnement de travail est conforme aux normes peut ainsi être demandée.
Par ailleurs, dans ce contexte de l’omniprésence du digital, les menaces de cyberattaques ne cessent de se renforcer et deviennent de véritables risques de sécurité. La protection informatique doit être maîtrisée car cela n’arrive pas qu’aux sociétés commerciales et les conséquences sont lourdes (perturbations des systèmes d’information et des activités clés). La cyberdélinquance présente de nombreuses extorsions qu’il faut être capable de contrer : campagnes d’hameçonnage, fraudes au paiement, problèmes de sécurité liés aux appareils ou aux logiciels, rançongiciel comptent parmi les principaux risques. Nombre d’associations connaissent la dangerosité des cyberattaques, mais les sous-évaluent encore trop souvent. Il devient important qu’elles mettent leur plan d’action et leur budget en adéquation avec la réalité de ces risques.
La supervision à distance
La confiance est à la base de l’organisation hybride. Toutefois, la Commission de l’informatique et des libertés (CNIL) a fait de la surveillance des salariés en télétravail l’une de ses trois thématiques prioritaires en 2022. Même si les éditeurs de logiciels de surveillance temporisent en indiquant qu’ils restent très minoritaires, la décision de la CNIL prouve que le sujet interroge.
L’employeur a le droit de contrôler l’activité de ses salariés à distance. En revanche, il doit veiller à ce que le contrôle soit proportionné. De plus, s’il décide de mettre des outils de contrôle en place, le salarié ainsi que les instances représentatives du personnel (IRP) doivent en être informés.
Réinventer le collectif et repenser l’organisation du travail
Susciter la cohésion et redonner du « sens »
Un autre enjeu du travail hybride est de réaffirmer l’importance du collectif. Quel est l’intérêt à retourner au travail ? Quand revient-on en groupe et pour quoi faire ? Il faut à tout prix éviter que la demande de présence soit traduite comme un manque de confiance ou comme la perte d’un avantage. Les organisations se trouvent dans l’obligation de donner un « sens » au retour au bureau.
La mise en avant de l’intérêt du collectif devient indispensable. Les moments de cohésion sont à repenser. Il est essentiel de démontrer qu’ils sont vecteurs d’entraide et de créativité. Ces dimensions qui tiennent à l’informel du présentiel sont à valoriser.
La mobilisation des acteurs dans le milieu associatif pourrait sembler plus simple que dans le secteur marchand. Le projet ou la cause qu’ils partagent est un élément constitutif fort de l’engagement qui aidera à retrouver ce fameux « sens ». Toutefois, il peut être opportun pour les associations de s’emparer de ces transitions pour repenser leurs façons d’être un collectif : pauses et repas communs, temps d’échange, événements, nouveaux rituels ou encore projets transversaux. La cohésion se suscite afin de s’avérer nécessaire.
Le télétravail pour questionner plus largement le rapport au travail
Les bénéfices apportés par le collectif justifient les temps de présence. L’erreur serait de reléguer les moments à distance à une simple question individuelle. Certes, l’augmentation de la qualité de vie est l’avantage le plus aisé à observer pour le télétravailleur. Pourtant, si les organisations en saisissent l’opportunité, un impact plus large sur la performance organisationnelle et économique pourrait s’opérer.
Le télétravail peut être vu comme un point de départ à l’évolution des méthodes de travail, des postures managériales et des modes de communication. L’idée est de questionner le rapport au travail en général, et non pas uniquement le rapport au télétravail. Le travail à distance devient alors une réflexion inclusive qui tient compte des télétravailleurs, des non-télétravailleurs, des managers et des partenaires. Il se révèle être une porte d’entrée à une réflexion sur la gestion d’un collectif afin de le rendre plus efficace. En menant cette démarche, la réponse apportée au besoin de « sens » évoqué ne peut qu’en être renforcée.
Une réponse aux enjeux contemporains
Le travail hybride est aussi l’opportunité de répondre à des problématiques actuelles (difficultés de recrutement, hausse du coût de l’énergie, dérèglement climatique, etc.).
Au-delà des seuls télétravailleurs, pour les associations, c’est aussi le cercle de bénévoles investis qui peut être élargi. Il peut être plus simple de s’impliquer au sein d’un bureau : participer à des conseils d’administration réguliers semble moins contraignant avec des réunions en ligne. Le contexte est favorable aux associations à chaque niveau en termes de ressources humaines : salariés mais aussi gouvernance, bénévoles, adhérents. Elles pourront plus facilement étoffer leurs équipes et développer leur maillage géographique.
Conclusion
La période de transition actuelle se révèle donc être l’opportunité d’améliorer la performance des organisations et la qualité de vie individuelle. En s’appuyant sur les socles légaux (accords, chartes, etc.) et en accordant suffisamment de permissions et de protections aux équipes pour qu’elles s’autoorganisent et s’améliorent en continu, chaque association pourra trouver la bonne voie, équilibrée, dans laquelle le travail hybride, sans être une fin en soi, sera durable et bénéfique.
Auteur : Alexis Legras
Directeur associé, GMBA
Juris associations n°661 – 15 juin 2022
[1] Dossier « Télétravail – Home à tout faire », JA 2021, no 638, p. 17.
[2] M. Robache, podcasts « Du télétravail subi au télétravail choisi », 2020.
[3] Microsoft, EY, « Livre blanc – Travail à distance : enjeux, impacts et opportunités par-delà la crise », 2021.
[4] C. trav., art. L. 1222-9 et s.
[5] M. Robache, Mettre en place et manager le télétravail, Eyrolles, 2020.