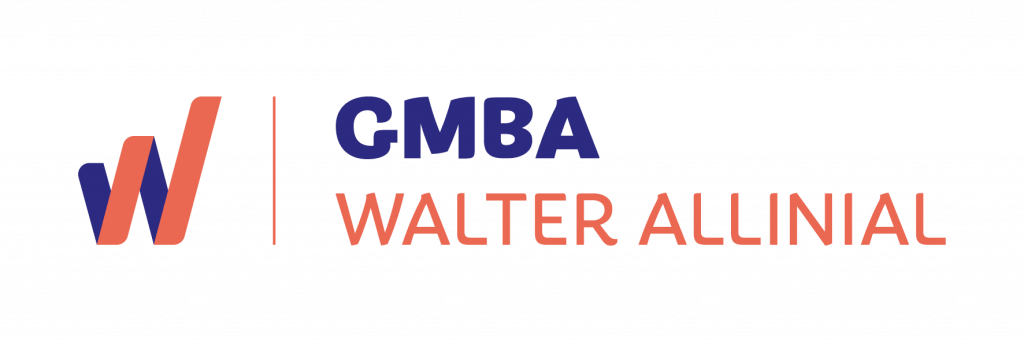Processus de décision : nos pensées sont-elles biaisées ?
Points de vue d’expert | 5 juin 2022
Le système cérébral est capable de traiter une information en quelques secondes à peine. Pour ce faire, le cerveau emprunte des circuits neuronaux systématiques et automatiques lui permettant d’intégrer les informations de manière rapide, régulée et efficace. L’information est analysée selon deux dimensions : les sensations et la pensée. C’est alors que la réalité de chaque individu prend forme, en interaction avec ce qui l’entoure.
Lorsqu’il s’agit de choisir entre plusieurs options, le cerveau s’active pour déterminer la solution la plus adaptée. La prise de décision repose sur une analyse coûts/bénéfices que chacune des situations peut apporter. Est-ce préférable de me rendre au bureau pour interagir spontanément avec mon équipe, ou bien de télétravailler en me concentrant sur mes missions prioritaires ? Dans cet exemple, le besoin d’efficacité est rempli dans les deux situations. En revanche, le choix interroge sur des besoins non exprimés qui pèsent sur la décision finale (sens des priorités, obligations professionnelles, cohésion d’équipe, gestion du temps, etc.). C’est seulement lorsque tous les ingrédients sont mis dans la balance, que l’intéressé-e est en mesure de les peser et de faire son choix.
Cette illustration décrit un processus de décision adapté. Cependant, il arrive que nos pensées soient influencées par des biais. On parle de biais cognitifs lorsque les schémas de pensées permettant de traiter rapidement l’information, suivent une logique trompeuse, fausse et/ou erronée. Ce phénomène, sur lequel il est intéressant de se pencher pour comprendre l’envers du décor de nos réflexions et de nos actes, est inconscient.
Intéressons-nous plus particulièrement aux biais cognitifs. A quoi servent-ils ? Faut-il les éviter ? Comment les exploiter à bon escient ? Quelle(s) information(s) nous apprennent-ils sur nous-même ?
Les biais cognitifs influencent nos choix
A en croire Jean-Paul Sartre, « nous sommes nos choix ». Cette citation témoigne de la dimension individuelle de nos décisions, parfaite traduction de notre système de valeurs, de notre éducation, de notre culture, de nos croyances, etc. De ce fait, nos choix sont influencés par notre histoire (mémoires sensorielle et cognitive).
Nous sommes également nos choix dans la mesure où nous décidons de tout ce qui nous arrive. Nous décidons de suivre certaines logiques de pensées, sciemment ou non. Ainsi, les biais cognitifs agissent comme une illusion d’optique sur notre façon de voir le monde.
Voici quatre exemples de biais largement répandus dans notre société et significatifs de la distorsion cognitive à laquelle notre système de pensée s’expose :
- Le biais de confirmation : c’est une tendance à retenir principalement les informations qui confirment un point de vue. Exemple : penser que la journée sera mauvaise parce qu’un évènement est venu perturber le quotidien. Se focaliser sur cette idée et occulter tout ce qui pourrait aller contre cette pensée. Un antidote ? Remettre en cause ses certitudes et questionner la relation de cause à effet avec objectivité.
- Le biais de négativité décrit une tendance à donner plus de poids aux expériences négatives qu’aux expériences positives et à s’en souvenir davantage. Dans cette configuration, la personne voit la vie négativement, se mine le moral avec des nouvelles négatives et pessimistes. A long terme, ce biais peut se transformer en état déprimé et fataliste. Un antidote ? Contrebalancer une idée négative par une idée positive, cultiver sa capacité d’émerveillement, relativiser, rêver.
- A contrario, le biais d’optimisme est la tendance à accorder plus d’attention aux bonnes nouvelles qu’aux mauvaises. Le risque ici est d’ignorer le mal et de s’exposer à des dangers (abus, agression, manipulation, …). Un remède ? Maintenir un niveau de vigilance suffisant.
- Le biais de dichotomie : c’est le fait de concevoir le monde selon deux polarités. C’est le principe du « tout ou rien », de « l’un ou l’autre », sans alternative ni nuance. La conséquence de ce biais est de perdre de vue la richesse du monde. Ce biais peut être vécu avec radicalité (aucune tolérance pour ce qui est différent ou s’oppose). L’antidote ? Préférer le « et » au « ou ».
Selon les situations, les décisions prises sous l’influence de ces habitudes de pensées entrainent des choix inadaptés, voire contraires à nos besoins, conduisant à la répétition de situations non désirées. Les biais cognitifs sont notamment à l’origine de stéréotypes (conclusions hâtives), d’erreurs de jugement et d’insatisfactions (incapacité à obtenir ce que l’on désire).
Les biais cognitifs comme leviers de croissance ?
Bien que les biais cognitifs soient utiles au cerveau pour fonctionner de manière optimale, ils gouvernent nos pensées et enferment dans des schémas limitants. Il existerait 250 biais cognitifs, c’est dire si notre cerveau a les moyens de nous jouer des tours !
Néanmoins, s’interroger sur les biais cognitifs est une manière de prendre du recul et de modifier son angle de vue. C’est identifier d’éventuels freins au changement, réaliser ce qui nous dépasse et ce qui peut être maîtrisé. Les biais cognitifs sont des indicateurs de comportements (préférences et intolérances). Ils sont autant de marqueurs de la complexité de la nature humaine. Ils révèlent les contradictions et paradoxes avec lesquels chacun(e) doit composer.
Reconnaître et cerner un biais cognitif permet la prise de conscience nécessaire pour conduire un changement. Au-delà d’interroger notre mode de pensée et nos croyances, ce mécanisme questionne notre capacité de discernement et à nous réinventer.